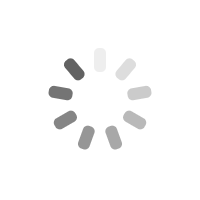Chlordécone :
Publié il y a un mois

Un rapport de l'ONU alerte sur les difficultés que rencontrent les victimes dans les affaires ayant trait à des substances toxiques pour se faire entendre par la justice. Le rapporteur de ce document préconise dans sa conclusion une vingtaine de recommandations pour faciliter les recours des plaignants.
Ce rapport de vingt-huit pages vise à présenter les grandes orientations pour améliorer l’accès à la justice et aux réparations pour les personnes soumises à certaines substances toxiques, telles que les polluants comme les molécules du chlordécone ou autres. Ce document de travail met en avant aussi les obstacles que peuvent rencontrer les victimes pour faire valoir leur droit, comme la charge de la preuve. "Dans bon nombre d’affaires ayant trait à des substances toxiques, les victimes sont tenues d’établir de manière indépendante les éléments essentiels de leur requête, c’est-à-dire de prouver, entre autres, l’existence d’une contamination et sa source" écrit Marcos Orellana, auteur de ce rapport.
D’autres barrières se dressent aussi devant les plaignants comme les délais de prescriptions, comme c’est le cas dans l’affaire du chlordécone, dont l'affaire a été mise en délibérée en 23 mars 2026. L'accès à l’information ou à la transparence n'est pas toujours garantie, car parfois certaines données concernant le polluant ne sont pas accessibles au grand public ou sont masquées. Bien souvent, les coûts financiers des procédures rebutent certaines victimes. "Les coûts prohibitifs des procédures judiciaires, qui comprennent les frais de saisine, de représentation juridique, de collecte des éléments de preuve et d’expertise, empêchent souvent les victimes de se pourvoir en justice […] les demandeurs risquent non seulement de perdre leur procès, mais aussi de devoir couvrir les frais de justice de la partie adverse" éclaire ce rapport.
Et parfois, les victimes sont confrontées à l’immunité d’État ou de certaines entités publiques. Dans ce rapport, les auteurs précisent que "toutes ces entraves aggravent les violations des droits de l’homme qui résultent de l’exposition à des substances toxiques."
Une série de recommandations
Si le rapporteur spécial s’inquiète des obstacles pour les potentielles victimes de polluants ou autres pesticides, il avance une série de recommandations que peuvent suivre les plaignants. Dans un premier temps, il recense les pratiques déjà adoptées dans le système judiciaire pour alléger certaines prérogatives. Le rapporteur prend l’exemple notamment d’une affaire jugée en Italie : "la cour n’a pas jugé nécessaire ou approprié d’exiger des requérants qu’ils démontrent un lien avéré entre l’exposition à un type identifiable de pollution ou même à une substance nocive et l’apparition d’une maladie précise mettant la vie en danger ou entraînant le décès des suites de cette maladie".
Dans ce même document, l’auteur propose 24 lignes directives que les états et institutions juridiques pourraient suivre. Exemple du numéro 2 : "les États devraient adopter des normes nationales relatives à la qualité de l’environnement, aux émissions et à la gestion des substances et déchets dangereux, conformément aux normes internationales et aux données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer, ou renforcer celles qui existent."
En conclusion de ce rapport, Marcos Orellana l’auteur, s’alarme sur le fait que la pollution toxique ne "cesse de s’intensifier et peut empêcher des millions de personnes de jouir de leurs droits humains."